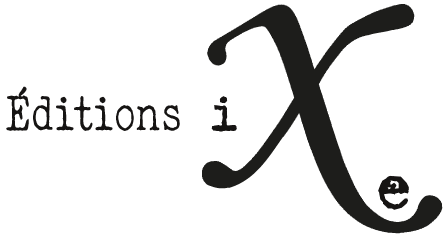Catherine Le Magueresse: «Quand on porte plainte pour un vol de sac, il est rare que votre parole soit mise en cause.»
Alors que plusieurs femmes ont accusé les deux anciennes vedettes de TF1, Patrick Poivre d’Arvor et Nicolas Hulot, de harcèlements et de violences sexuelles, la juriste revient sur la réception des témoignages, l’évolution du droit, et montre que la justice est encore souvent engluée dans des préjugés sexistes.
La justice doit-elle se réformer pour mieux lutter contre les violences sexuelles ?
Catherine Le Magueresse est juriste et elle a présidé de 1998 à 2008 l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Devant les difficultés rencontrées par les victimes pour faire valoir leurs droits, elle s’est engagée dans une recherche universitaire sur la prise en compte juridiques et judiciaires des violences masculines à l’encontre des femmes, qui l’a engagée à creuser comment la notion de consentement s’est élaborée à travers les siècles. Autrice de Pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel paru il y a quelques mois aux Éditions iXe, et grande habituée des récits d’agressions sexuelles et viols, elle réagit à notre enquête parue le 8 novembre, où huit femmes dont sept à visage découvert, prenaient la parole pour dénoncer des faits de harcèlements et de violences sexuelles qu’elles auraient subis de la part de Patrick Poivre d’Arvor.
Qu’est-ce qui vous frappe dans les témoignages des femmes qui mettent en cause deux anciennes vedettes de TF1, Patrick Poivre d’Arvor et Nicolas Hulot?
J’aimerais souligner leurs motivations : elles dénoncent les violences pour leurs filles et les autres femmes afin qu’elles ne se reproduisent pas. L’autre fait remarquable parmi les accusatrices de PPDA est l’incidence de ces violences dans leur vie personnelle et professionnelle. D’après ce que certaines décrivent, alors même que l’homme a pris son dû, elles subissent des représailles. La responsabilité de TF1 pourrait être engagée si on considère qu’il y a une violation de l’obligation de sécurité à laquelle tout employeur est tenu. Que la seule prévention soit assurée par les anciennes qui disent aux nouvelles arrivées qu’elles ne doivent pas aller dans ce bureau est contraire à la loi. L’une des accusatrices de PPDA explique qu’elle a connu trois agressions sexuelles dans l’entreprise et que c’est l’une des
raisons de son départ.
Que disent les témoignages sur le statut du consentement ?
On voit qu’il n’est pas envisagé. L’homme se croit irrésistible, et la femme doit succomber.
Chacune décrit un homme dans la toute-puissance. Il n’est ni dans l’échange, ni dans la séduction, ni même dans une relation avec un autre être humain. Il objective les femmes qui se présentent à lui et instrumentalise leurs attentes pour assouvir son désir. Faire partie du top des personnalités préférées des Français permet peut-être d’être convaincu de son impunité et paraît effacer tout repère, toute norme.
Pourquoi au sein de l’entreprise, les contre-pouvoirs ont-ils échoué face à cette toute-puissance, qui est aussi une construction ?
D’après ces femmes, TF1 a surtout nié le danger dans lequel elles étaient. Il y a une responsabilité très particulière d’être au courant et de ne rien faire, qui, en droit, entraîne une responsabilité immédiate de la part des structures et des individus concernés. Rappelons que la loi sur le harcèlement sexuel imposant à l’employeur de mettre en place des actions a été adoptée en 1992 ! L’obligation de réagir a été renforcée depuis 2012, mais les interdits légaux sont posés dans le code du travail depuis trente ans. En revanche, à l’époque, il n’y avait pas de pression sociale. On disait : «C’est un malade, c’est un pulsionnel».
N’y avait-il pas culturellement une admiration des hommes capables d’établir des
«listes» et «des tableaux de chasse» ? Casanova était perçu comme un modèle pas
seulement littéraire…
Sans doute. Mais il n’empêche que les grandes entreprises ne pouvaient ignorer cette loi de 1992. On ne voulait pas savoir en raison de la personnalité des mis en cause, parce que les coûts économiques et politiques des dévoilements de ces violences auraient été trop lourds. C’est très cynique.
De quelle manière le consentement est-il inscrit dans la loi ?
Le consentement n’est pas inscrit dans le code pénal. Selon la jurisprudence, le défaut de consentement se manifeste par l’utilisation de la violence, menace, contrainte ou surprise afin d’obtenir un contact sexuel. Mais lorsqu’on dit «défaut de consentement», on part du principe que la personne est présumée consentante. Jusqu’à la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, les enfants étaient également présumés consentants et il leur fallait prouver que l’adulte avait bien exercé contre lui ces éléments constitutifs du viol. C’est aberrant car on sait bien que les adultes ont tout de sorte de ruses pour manipuler les enfants afin de leur imposer des contacts sexuels.
Si le consentement n’est pas inscrit dans le code pénal, le viol change-t-il de définition
au fil des siècles ?
Dans l’Ancien Régime, il fallait que la femme prouve son absence de consentement en ayant crié à plus de quatre lieues, qu’elle porte des traces de coups sur elle, et qu’elle ait résisté au-delà de ses forces ! Le viol a ensuite été inscrit dans le premier Code pénal de 1791 mais il n’y est pas défini. Il ne l’est pas plus dans le Code napoléonien en 1810, et c’est la jurisprudence qui va en établir les caractéristiques sans jamais prendre en compte positivement le consentement. Pour qu’il y ait viol, il faut qu’il y ait violence. Au milieu du XIXe siècle, une femme est violée pendant qu’elle dort par le camarade de son mari – en train de s’abreuver à la taverne. Le camarade se fait passer pour le mari et viole la femme. Comme dit pudiquement l’arrêt, elle se prête aux demandes conjugales – la loi exclut la possibilité d’un viol conjugal – quand tout d’un coup, elle conçoit que l’homme à ses côtés n’est pas son époux et elle crie. La Cour de cassation note que bien qu’aucune violence n’ait été exercée, la surprise devrait être prise en compte pour caractériser l’absence de consentement, et qu’il s’agit d’une femme «bien», qui a immédiatement manifesté son désarroi. C’est en juin 1857, à partir de ce procès que la jurisprudence intègre l’élément de surprise. Toute cette construction jurisprudentielle est reprise dans notre Code pénal actuel.
Dans notre enquête sur l’affaire PPDA, plusieurs des témoins ont d’abord minimisé ce qu’il leur était arrivé, préférant parler «d’incident malencontreux» ou de «dérapages». Les appréciations de menace, surprise, contrainte ou violence sont-elles subjectives ?
Ces termes ne sont pas plus définis par le code pénal et sont le fruit d’une définition jurisprudentielle. Si bien que durant un procès, il n’est pas rare que soit demandé à la victime si elle a reçu une petite tape ou une claque qui lui a fait tourner la tête. On va évaluer si la violence est suffisante pour renverser la présomption de consentement. Curieusement la contrainte économique n’est quasiment pas reconnue. Je me souviens d’une femme, soutien de famille et violée par son employeur. La juge d’instruction lui avait demandé pourquoi elle n’avait pas démissionné après le premier viol et avait établi qu’il n’y avait eu ni contrainte, ni violence, ni menace, ni surprise, parce qu’elle aurait dû s’attendre à ce que son patron récidive. Pourtant, la contrainte économique est un rapport de force qui peut être exploité pour imposer des agissements sexuels. En sachant très bien que dans ce cas l’impunité est quasiment garantie.
Préconisez-vous un changement législatif pour que les femmes (et les hommes) ne
soient plus présumés consentants ?
Plusieurs pays – et le Canada fut le premier en 1992 – ont inscrit dans leur Code pénal une définition positive du consentement. Le consentement est l’accord volontaire donné à la personne en tenant compte des circonstances environnantes. Par exemple, si je suis dans un lien de subordination, mon «oui» va être suspect. Car je peux dire «oui» faute de choix. Pour que mon «oui» efface la responsabilité pénale, il faut qu’il n’y ait pas de représailles au cas où je dis «non». Autrement dit, avoir la liberté d’énoncer véritablement son accord. Si je suis sous emprise alcoolique, l’acquiescement n’est pas valable non plus. Le code pénal canadien exclut la validité d’un consentement d’une personne qui n’est pas en état de le formuler. Il y a obligation de s’enquérir du consentement dans les pays anglo-saxons et en Suède depuis 2018, et depuis il y a une augmentation des plaintes pour viol de 70 %. L’Espagne est également en train de modifier sa législation. En France, une femme sur dix seulement va déposer plainte au commissariat en cas de viol. Et elles le font quand elles pensent que ce viol coche toutes les cases du stéréotype : s’il a eu lieu par un inconnu, et qu’elle garde des marques physiques sur elles. Cette définition stéréotypée du viol qui s’est construite durant l’Ancien Régime est fortement intériorisée. Ainsi, le viol conjugal est très peu dénoncé et il est massivement classé sans suite.
Que répondez-vous à ceux qui disent que les accusations qui visent PPDA et Hulot
témoignent d’un vieux monde qui a périclité ?
Le discours d’Eric Zemmour sur les femmes cristallise une approbation qui montre que la haine des femmes a de beaux jours devant elle. Même si l’engagement des jeunes gens témoigne d’un changement non négligeable en faveur de l’égalité. Mon expérience de quinze ans d’écoute et d’accompagnement des victimes au sein de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail m’a permis d’observer que la justice est trop souvent engluée dans des représentations sexistes. Il ne faut plus demander aux femmes comment elles ont résisté mais aux hommes comment ils s’étaient assurés du consentement.
La sociologue Irène Théry a proposé de faire entrer dans l’arsenal législatif la notion de «crédit de véracité» qui permettrait aux personnes qui dénoncent des violences sexuelles de ne plus être soupçonnées de mentir, jusqu’à preuve du contraire. Qu’en pensez-vous ?
Une justice impartiale rendrait inutile ce concept. Quand on dépose plainte pour un vol de sac, il est rare que votre parole soit mise en cause. Pourquoi ne serait-ce pas le cas lorsque la plainte concerne des violences sexuelles ? Dans toutes les démocraties occidentales, des études montrent que les fausses allégations ne touchent que 2 % à 8 % des personnes. Pourquoi choisir la mini-exception statistique et considérer qu’a priori une femme ment ? Il faut poser que la personne qui vient déposer plainte pour agressions sexuelles dit la vérité et à partir de sa plainte, chercher les preuves. Et conserver précieusement la présomption d’innocence et le doute qui profite à l’accusé, qui garantissent qu’une personne ne sera condamnée qu’à l’issue d’un procès équitable. En revanche, quand les acteurs de la chaîne judiciaire sont porteurs de préjugés qui les amènent à douter de la parole de la victime, ils font une erreur professionnelle et ne se donnent pas les moyens de constituer la preuve des violences. Ce sont ces préjugés qu’il faut modifier et non mettre en place un nouveau concept.
Catherine Le Magueresse, Les pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement. Éditions iXe, 228 p. 16 €.