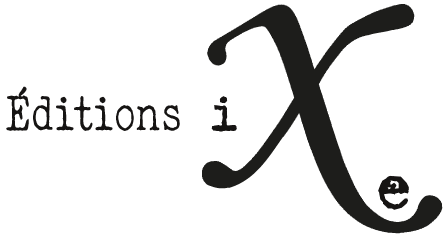« Préambule. L’évocation de l’épisode fondateur de mes prisons intérieures ne se fera pas sans la traversée des sanglots. Ecrire ne me donnera pas la force de m’exprimer de pleine voix, les mots inconnus de ce drame se sont fossilisés depuis une quarantaine d’années ».
Une phrase répétée, une phrase de plomb, « Rien n’est arrivé de grave depuis que ma mère a hurlé ». Un été au milieu des années 70, une enfant, un lieu (mais cela pourrait-être des milieux de lieux, des milliers d’autres fillettes. En vérité ce sont des milliers de fillettes dans des milliers de lieux).
Des paroles enfermées dans le cachot de l’intimité, des paroles murées, impossibles à approcher, impossible à visiter. « Tant que je n’aurai pas réussi à les convaincre de m’accompagner vers la lumière, ces paroles m’exposent à la toute-puissance de ma mère, à sa colère inattendue, toujours aussi terrifiante ».
L’impuissance devant ces paroles prononcées ou ravalées. Ce qui n’a pas été dit et le mensonge qui prit le relais. La victime rendue coupable, une fois encore, comme dans le refus habituel de saisir le sens social et politique de la violence. Le regard en arrière, tenter de revenir sur des lieux et des faits dans sa tête, « Immobile, je refaisais le trajet, modifiant des bribes cruciales des faits ». Une enfant, une fillette de 9 ans, la mémoire en deux langues qui « jouent ensemble à saute-mouton », les mots qui ajoutent à la violence subie, les mots maternels, et ce « violet », « Ce mot était la première clé de la trappe que j’avais camouflée avec un mensonge ». L’enfance n’est pas ici celui des contes et des merveilles (il en est de même de millions d’enfances dans des milliers de lieux, des enfances fracassées…), « L’enfance est un empire régi par des matons qui savent tout de l’adulte que tu deviendras ».
La respiration, le désespoir, les suffocations, les puissants sanglots – et des pleurs quarante ans après pour un détail échappé -, la liste de ces gestes agressions et de ces lieux « où la seule présence d’une fille était une autorisation en règle pour la palper, l’embrasser, lui pincer un sein ou les fesses », l’appropriation collective des corps des femmes avant leur appropriation privative, le refuge sous le lit, les mot – « sous la pluie acide des mots maternels » – publiquement répétés, « Affligée, humiliée d’entendre parler de moi en ma présence, comme si j’étais un objet », la nausée, la traître solitude, cet oncle qui cloitrait les femmes de sa tribu, « Qu’ont-ils tous vécus pour être aussi fragile face au désarroi d’une enfant abusée ? »
Des mots qui ne figuraient pas encore dans les armoires à mots de l’autrice, des actions déniées par le vocabulaire mensonger, le mot safoune de la broche brulante en pénétration d’une jeune mariée, les mots appris en obstétrique…
Des autres gestes, d’autres hommes, d’autres violences sexuelles. Et cette gifle reçue, la violence ciblant plus les filles que les garçons, un épisode appartenant à « la liste noire que je suis seule à connaitre », un souvenir comme un autre « où nous servions de poupées sexuelle au jeune homme », le fleuve creusé par le mensonge « entre ma mère et moi », l’espace extérieur et le mot viol…
Un tissu opaque revêt et couvre de mensonges une (des) enfance(s). « Rien n’est arrivé de grave depuis que ma mère a hurlé ». Nous saisissons alors tous les sens possibles du beau titre de cet ouvrage.
Souad Labbize : Enjamber la flaque où se reflète l’enfer
Dire le viol