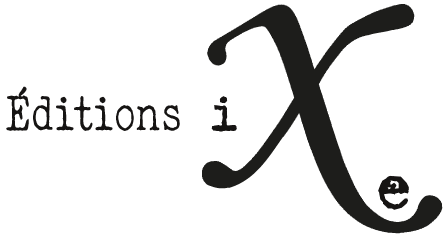Livre d’une grande richesse. Écrit avec la rigueur argumentée de la philosophie et l’éclat et la fulgurance de la poésie, et ce non pas en alternance mais en simultanéité fusionnelle. Donc, dans l’écriture même, est défaite l’appartenance à un genre littéraire – mais ne serait-ce que dans les rayons des librairies, il est évident que c’est un « essai », terme où l’on trouve un aspect de tentative, hasardeuse et hardie, et l’aspect de constante expérimentation qui en fait aussi un permanent « chantier », parfois chaotique et souvent lumineux. De surcroît, offrant une sorte de mise en abyme, l’ouvrage exemplifie ce dont il parle : la manière dont l’écriture et la vie « tiennent ensemble sans couture et sans clôture, comme tiennent sans couture le poétique et le théorique, la fable et l’essai philosophique, l’image et le concept ».
Deux auteures : signature double pour une aventure intellectuelle commencée il y a des années en dialogue et débat, et menée à bien (à lisibilité et à publication) par Katy Barasc après le décès de Michèle Causse, l’auteure entre autres de L’encontre et du Voyage de la Grande Naine en Androssie, qui a « choisi de s’absenter » en 2010. L’origine singulière et personnelle est affirmée d’emblée par Barasc : ce livre, dit-elle, n’existerait pas « sans la volonté de Michèle Causse, sans son vouloir penser et écrire en dyade ». Nous pouvons ajouter qu’il n’existerait pas non plus sans l’intransigeante volonté de Barasc, son énergie à poursuivre la tâche exigeante et périlleuse, et à constituer ainsi la suite – selon une polyphonie à deux voix parfois disjointes mais où « advient l’unité » – de Contre le sexage (2000), ouvrage théorique et militant, indissociablement poétique et politique, où s’exprime la pensée féministe de Causse.
Commencer par un « état des lieux » : nous sommes en état d’exil et d’exclusion. C’est l’exclusion des femmes qui subissent l’élimination du symbolique et n’ont pas de site ontologique propre, et qui ne sont jamais que « l’objet d’échange de sujets détenteurs du sens ». En effet, le Même « fait Loi : un seul corps, un seul désir, une seule interlocution ». Les femmes sont ainsi « les exilées de l’universel abstrait ». Barasc revisite avec acuité le mythe de l’androgyne tel que présenté par Aristophane dans le Banquet de Platon. Dans cet être double est privilégiée l’association H/H, tandis que l’association H/F est réservée (restreinte) à la procréation pour l’espèce, et que l’association F/F passe à la trappe. Et voilà les lesbiennes silenciées. Mais chez Sappho, l’expérience amoureuse est « expérience noétique ». Barasc lui consacre plusieurs très belles pages, avec une méditation insistante sur la « corporéité désirante » irréductible au corps objectif genré, et qui se décalque du grec selon le terme de phrenes. Quant à l’homosocialité grecque, elle s’approprie le logos. Exclusive et excluante. D’où la question : comment habiter un lieu « dans lequel il n’est pas d’habitat possible, pas d’hospitalité » ?
On en arrive à une problématique du genre et de la langue, et du lien entre langue et réel. « La langue constitue le réel. En choisissant sa langue, on choisit son réel ». L’androlecte, ce logos indexé au phallus, a été défini par Causse dans Contre le sexage : « Le seul sexolecte existant est l’androlecte, passant pour neutre et qui véhicule en fait la pensée, les visions et visées d’un sexe dit fort (mâle) au détriment d’un sexe dit faible (femelle), […] élaboré par le détenteur du phallus, il instaure l’inégalité entre les animés de l’espèce humaine ».
Simone Weil, la philosophe qui a subi la contrainte (meurtrière) du cartésianisme légué par son maître Alain, et la biologiste Barbara McClintock (« invisibilisée », alors qu’elle a démontré qu’il existe des gènes de régulation, et donc que « le génome n’est pas figé mais qu’il s’agit d’une entité dynamique »), témoignent, parmi d’autres, de cet état de fait : être contraintes à écrire dans langue de leur exclusion.
Le refus de la marque du genre est refus « de la neutralité et des arraisonnements sexcisants, en même temps qu’affirmation des corporéités singulières » afin de se rapproprier son site d’énonciation et de production du savoir. La mise en question de différentes modalités du binarisme, et le refus d’un neutre qui serait pur produit de la confusion ou de l’effacement. Référence est faite à Roland Barthes. Il convient donc de « déschématiser les catégories de l’identité et de les arracher à la logique de la reconnaissance », laquelle « manque l’objet » en le réduisant soit à une idéalité – posture de l’ascétisme – soit à un résidu innommable – c’est la pornographie. Barasc démontre comment l’ascétisme et la pornographie ne sont que le double visage d’une même tradition. La pornographie, entre autres, définissant « l’avoir de l’organe comme être », effectue la mise en scène « d’une toute-puissance exercée sur l’objet montré en disponibilité de ses orifices ». « Exténuant tout imaginaire », elle exécute la mécanisation torturée des corps des femmes.
Le gynolecte exprime la revendication d’une écriture spécifiquement féminine, explorée avec des intelligences diverses par des écrivaines comme Chantal Chawaf, Annie Leclerc, Luce Irigaray, Hélène Cixous, Julia Kristeva. Barasc met en exergue « l’aporie d’une libération qui essentialise la différence en faisant de la réappropriation du corps le centre de la praxis d’écriture ». Il s’agit d’aller au-delà du gynolecte avec celles que Barasc appelle les anthropolectales, instruites de l’anthropologie et lui faisant dire ce qu’elle occultait : Colette Guillaumin, NicoleClaude Mathieu, Monique Wittig… Avec elles il sera possible d’échapper à la perversité de l’alternative : ou bien endosser la posture du sujet différent toléré par le Même, ou bien disparaître dans l’inaudible. Il faudra donc, à travers l’exercice même du langage, « détruire le genre totalement ». Et ainsi faire advenir un sujet qui ne soit plus assujetti au genre. Déjà formulé par Wittig comme contrat linguistique, le contrat social est celui de l’hétérosexualité. Wittig pratique la subversion des récits canoniques dans des montages intertextuels. Wittig et Causse sont ces « arpenteuses pionnières du déjà-là textuel… des aventurières qui font événement de ce qui manque à la langue ». Or le « chantier de la langue » est d’emblée pour Causse « chantier du discours amoureux ». En effet, une constante de l’œuvre causséenne est d’être « à la fois amour de la langue et langue de l’amour ».
Accord avec les recherches linguistiques de Claire Michard, avec les recherches épistémologiques d’Hélène Rouch, de Donna Haraway, d’Isabelle Stengers, de Vinciane Despret. Création d’un « imaginaire épistémique en rupture avec les démarches réductionnistes ». Accord avec Édouard Glissant et son appel à une « insurrection infinie des imaginaires libres ». Accord avec Virginia Woolf et le
transgenre d’Orlando, à la fois le personnage et le livre qui franchissent les genres du roman, les brouillant dans le corps littéraire de l’œuvre.
Création de l’alphalecte, seul langage acceptable et souhaitable, même si la marque alpha demeure imprononçable. L’alphalecte a pour vocation d’inscrire les corporéités désirantes « là où leur désir ne plie pas devant les assignations », notamment celles relevant des rapports sociaux de domination.
Création de nouveaux pronoms qui délivrent de l’assignation binaire au genre : il s’agit de mettre au repos (… éternel ! – si nous suivons ce que suggère le titre liturgique de Requiem) la partition générique et de lui donner congé tout en luttant contre la fiction dominatrice de l’universel neutre masculin. Inventer un pronom « dégénéré », selon l’expression de Michèle Causse (Défigures de soi). Ce sera : « UL ». Forgé à partir de la première et de la dernière lettre de UniverseL et par ailleurs première syllabe de ULtime, ce qui en suggère l’indication d’utopie… Récusant l’universel-neutre-masculin, UL dit : « ni deux ni maître ». Dans la mesure où UL rend possible l’existence indifférente des distinctions, il est le contraire de la neutralité. Il fournit « une pronomination de soi en rupture avec IL et ELLE ». Enfin
UL « fait communauté avec UL, ne se constituant qu’en relationnalité, interaction et interlocution », ce qui permet aux ULS de faire monde « en multiplicités de modes désirants, en sensualités connectées hors des frontières du genre ».
Toute en filigrane subtile et fluide comme une eau souterraine, une secrète mélodie (en grec : melos…) parcourt ce REQUIEM POUR IL ET ELLE. Elle lui confère le rythme de vive allure d’un book-movie, enclenche une démarche en allégresse symphonique. Un élan musical ouvre la voie à une échappée vers l’ailleurs. Et c’est alors « une autre histoire qui commence, d’autres histoires d’amour et de pensée,
d’autres tissages en philia…», puisque l’alphalecte propose « d’autres optiques, d’autres sujets, d’autres corporéités, d’autres circuits de connaissance, de désir, d’écriture », avec « la promesse joyeuse d’une exténuation du binarisme, la promesse d’une langue délivrée ».