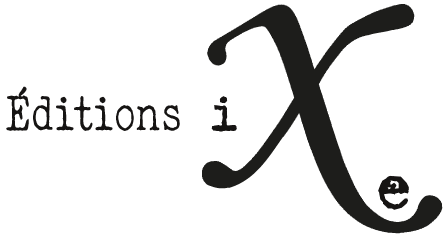« Je trouve assez stupéfiant qu’on parle d’amours adolescentes entre une enfant de 13 ans et un jeune de 18 ans »
Dans un entretien au « Monde », Catherine Le Magueresse, chercheuse, se réjouit du projet de loi visant à protéger les mineurs des crimes sexuels adopté jeudi, par le Parlement.
Chercheuse associée à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris-I Panthéon-Sorbonne), autrice de l’ouvrage Les pièges du consentement (Editions iXe, 228 pages, 16 euros), Catherine Le Magueresse salue la pénalisation de toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, adopté définitivement jeudi 15 avril, par le Parlement. Elle regrette toutefois un débat trop peu approfondi.
La proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes sexuels de la sénatrice Annick Billon fixe un interdit légal de toute sexualité entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Est-ce une avancée que vous saluez ?
Très clairement, oui. C’est une demande portée depuis plusieurs années par plus d’une trentaine d’associations, réunies au sein du Collectif pour l’enfance [CPE]. Cette disposition, qui existe dans une multitude de pays, est aussi très attendue des Françaises et des Français, qui tombent bien souvent des nues quand ils apprennent que la loi actuelle ne protège pas spécifiquement les mineurs. Pour ces derniers, comme pour les victimes majeures, il est, en effet, nécessaire, pour caractériser un viol, de prouver l’existence d’une contrainte, menace, violence ou surprise.
Depuis l’affaire de Pontoise, [en 2017, la justice avait décidé de juger un homme qui avait des relations sexuelles avec une enfant de 11 ans pour « atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans », en dépit d’une plainte déposée pour « viol ». Le parquet avait considéré que la contrainte ne pouvait pas être établie] l’opinion publique a été informée des failles béantes de la protection des mineurs et attend donc que le système soit amélioré. C’était aussi un engagement d’Emmanuel Macron, dans son discours de 2017 à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Mais jusqu’à présent, il n’a pas été tenu : le gouvernement ayant, finalement, reculé au moment de l’adoption de la loi de 2018 sur les violences sexistes et sexuelles.
A l’époque, le Conseil d’Etat, saisi pour avis, s’était opposé à la fixation d’un seuil d’âge au motif qu’elle bafouerait la présomption d’innocence du mis en cause. Ce qui est regrettable, c’est que sur ce point, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie pour une affaire au Royaume-Uni, apportait déjà une réponse claire. La juridiction européenne indiquait ainsi dans un arrêt rendu en 2011 qu’il était possible d’introduire dans le droit pénal des incriminations interdisant une interaction sexuelle entre un adulte et un mineur, à la condition qu’elles soient caractérisées par un élément matériel – comme le contact de nature sexuelle – et un élément intentionnel – le fait de vouloir ce contact.
Pourtant, quand la question s’est posée en France lors des débats sur la loi de 2018, le Conseil d’Etat s’est contenté de s’opposer à la création d’une présomption de non-consentement irréfragable, mais s’est bien gardé d’évoquer la piste de l’interdit légal qui est aujourd’hui débattue par les parlementaires, et qui existait déjà.
Le terme de consentement sexuel n’apparaît pas explicitement dans le code pénal. Vous relevez qu’il est pourtant au cœur du débat public sur le viol comme lors des débats qui ont précédé l’adoption de la loi de 2018. Faut-il définir et inscrire cette notion dans le code pénal ?
Oui, c’est la proposition que je défends dans mon livre, en m’appuyant sur l’exemple canadien, premier pays à avoir inscrit le consentement positif dans le droit, en 1992. C’est une disposition qui s’appliquerait pour les victimes majeures, celles qui ont une capacité à consentir, ce qui n’est pas le cas d’un mineur de moins de 15 ans, pour lequel l’interdit légal actuellement en discussion me semble être la bonne solution.
Mais pour les majeurs, dans notre droit actuel, le refus simple de la victime ne suffit pas pour prouver le viol. Il faut impérativement prouver qu’il y a eu pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. Cela sous-entend que les femmes – qui sont les principales victimes de viol – sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, consentantes à toute relation sexuelle. Inscrire dans la loi le consentement positif, qui revient à dire que les deux parties doivent exprimer librement leur accord à une relation sexuelle, renverserait cette approche.
Au Canada, c’est une mobilisation féministe qui a abouti à cette loi, après des débats très forts parce qu’on touche là au droit d’accès au corps des femmes, qui est une pierre angulaire du patriarcat. Il y a eu après son adoption une forte résistance judiciaire, régulièrement corrigée par la Cour suprême du Canada. Mais le plus important, c’est qu’on peut désormais enseigner qu’on a l’obligation de s’assurer du consentement positif de l’autre, sinon c’est un viol, ou une agression sexuelle en l’absence de pénétration. C’est un pas très important parce que ça change les mentalités et que, au tribunal, c’est à l’agresseur d’expliquer comment il s’est assuré de ce consentement, et non plus à la victime de justifier sa réaction.
Les associations dénoncent l’introduction, dans la loi en cours d’examen, d’un écart d’âge de cinq ans entre le mis en cause et la victime. Cette disposition est défendue par le ministre de la justice, au prétexte que la loi ne doit pas criminaliser les « amours adolescentes ». Qu’en pensez-vous ?
Je trouve assez stupéfiant qu’on parle d’amours adolescentes entre une enfant de 13 ans et un jeune de 18 ans. Il suffit d’observer les jeunes gens, d’échanger avec eux, pour constater qu’à ces âges-là, cinq ans d’écart, ce sont deux mondes séparés. Pour l’illustrer autrement : à 13 ou 14 ans, on est au collège. A 18 ou 19 ans, on a passé le bac et quitté le lycée.
Une relation sexuelle à 13 ans peut représenter une effraction psychique, qui abîme un enfant. Le CPE explique très bien qu’à 13 ans, on n’a pas encore véritablement de sexualité. Il faut rappeler que la première relation sexuelle a lieu en moyenne vers l’âge de 17 ans. Donc pour moi, cet écart d’âge, qui n’est fondé sur rien de sérieux, est une véritable bombe à retardement et une mise en danger des enfants. Les parlementaires ont une responsabilité énorme de laisser passer ce texte en l’état, alors qu’ils sont théoriquement les garants de la protection des mineurs.
Plus globalement, je suis choquée dans ces débats parlementaires de voir à quel point les débats sont peu sourcés. Eric Dupond-Moretti parle d’amours adolescentes sans jamais donner d’éléments pour cerner la réalité qu’il évoque. Quels sont les chiffres du ministère de la justice sur les procès de viols entre mineurs ? Combien de plaintes cela représente-t-il ?
Si on regarde les condamnations pour viol sur mineurs de moins de quinze ans, presque la moitié des auteurs sont eux-mêmes mineurs. Il se peut qu’il y ait un biais de sélection, que ces affaires soient davantage que les autres renvoyées devant les tribunaux, mais alors que les parlementaires sont en train de voter une loi extrêmement importante, ces données ne sont pas même évoquées.
Dans le chapitre de votre ouvrage consacré aux mineurs, vous proposez une autre piste, celle de seuils différenciés. De quoi s’agit-il ?
Dans plusieurs pays, des seuils différenciés ont été mis en place pour ne pas frapper d’illégalité les relations consenties entre mineurs, et laisser vivre les amours adolescentes mais dans des écarts d’âge qui correspondent à des réalités. Cela consiste à prévoir des exceptions au seuil d’âge général. Au Canada, par exemple, où le seuil d’âge est fixé à seize ans, un enfant de 12 ou 13 ans peut avoir des relations consenties avec quelqu’un de deux ans son aîné sans que cela tombe sous le coup de la loi.
Pour les adolescents de 14 et 15 ans, l’écart d’âge avec le ou la partenaire doit être inférieur à cinq ans, écart que je trouve trop important. Et dans tous les cas, la personne la plus âgée ne doit pas être en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la plus jeune.
C’est une piste qui devrait être explorée, en demandant à des médecins, des pédopsychiatres, des magistrats de discuter de ces écarts d’âge. Il faudrait regarder les statistiques des viols entre mineurs pour savoir où se pose le problème, plutôt que de décider de façon très arbitraire la mise en place d’un seuil d’âge de cinq ans comme le fait le gouvernement.
Lors des débats, l’argument de l’inconstitutionnalité est souvent brandi. Il l’est aussi par les associations qui s’élèvent contre la définition de l’inceste retenue par les parlementaires, différente de celle qui figure dans le code pénal aujourd’hui. Le texte, s’il est voté en l’état, risque-t-il d’être inconstitutionnel selon vous ?
Je tiens à saluer le travail juridique réalisé notamment par l’association Face à l’inceste, qui montre que la question de la clarté de la loi se pose. Mais pour qu’il y ait des questions prioritaires de constitutionnalité [QPC], il faut que suffisamment de sénateurs ou de députés saisissent le Conseil constitutionnel, je ne suis pas certaine que ce sera le cas dans l’immédiat.
Mais à terme, c’est effectivement un risque. Or, en cas de censure du Conseil constitutionnel, il faudra que les parlementaires se remettent à l’ouvrage et, ce qui est pire, c’est que toutes les procédures risqueraient de tomber, comme ce fut le cas au moment de la censure de la loi sur le harcèlement sexuel, à la suite d’une QPC posée par un condamné. Dans des affaires de violences sexuelles sur mineurs, ce serait absolument terrible.