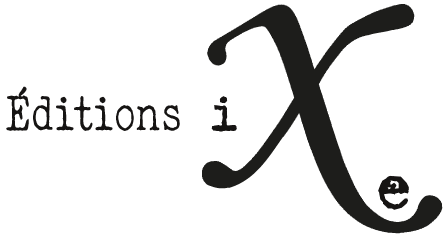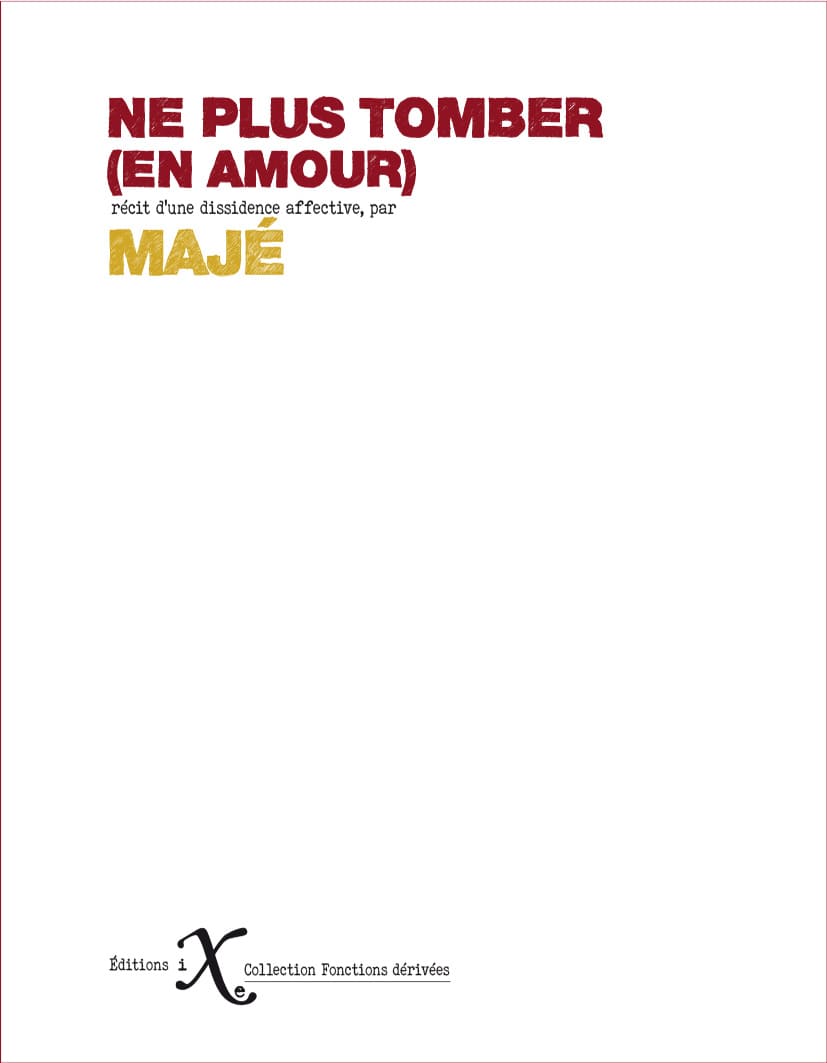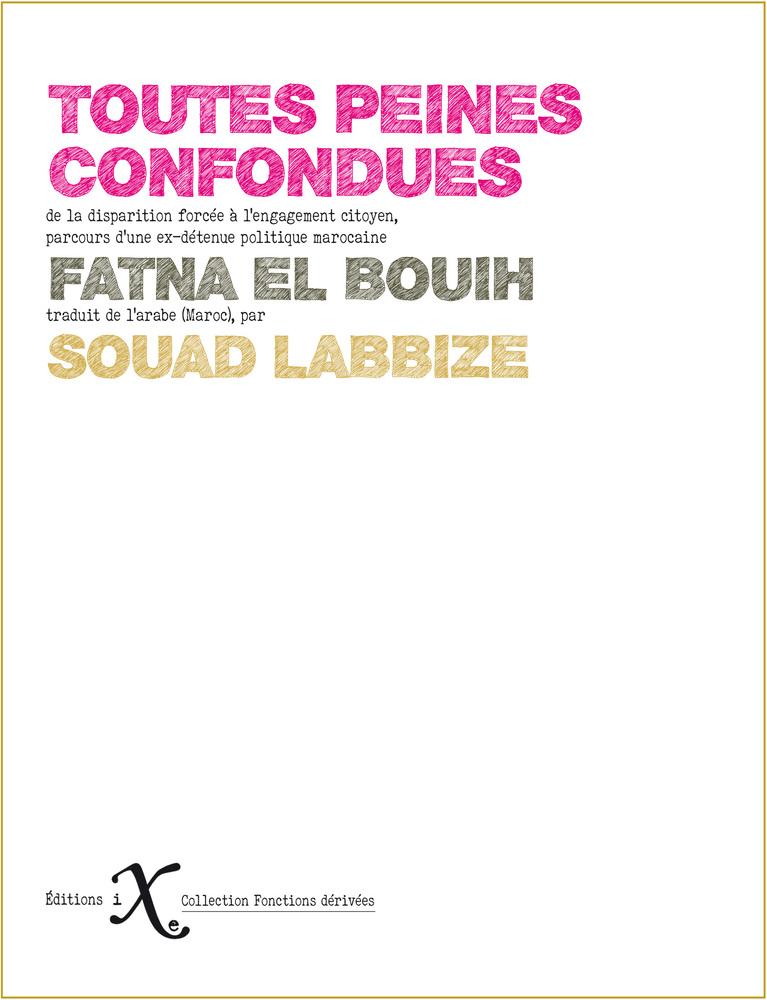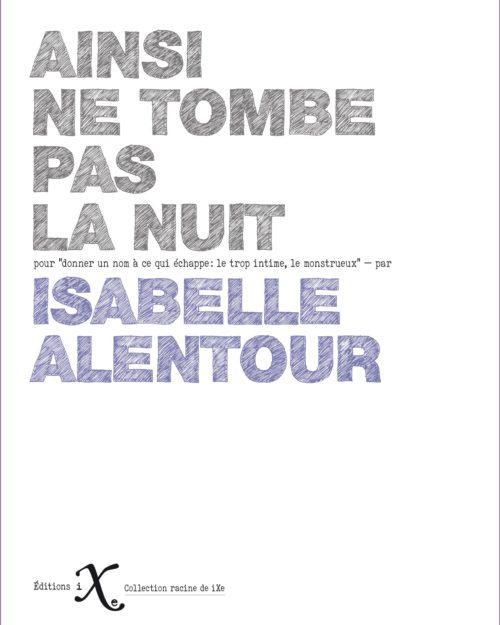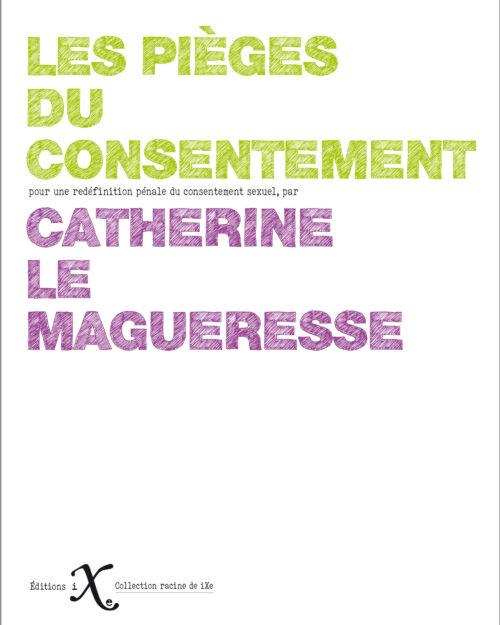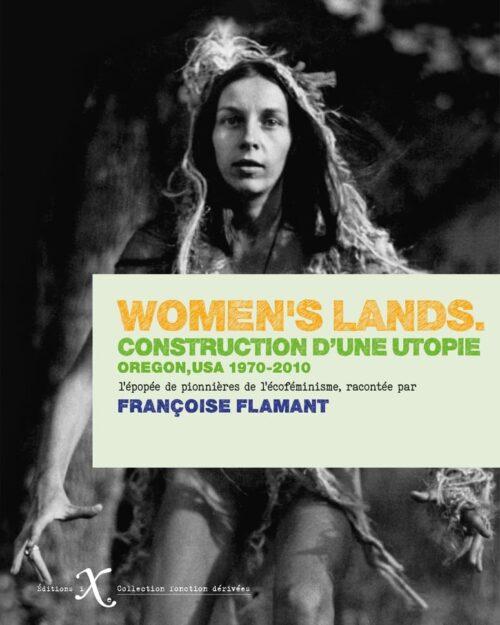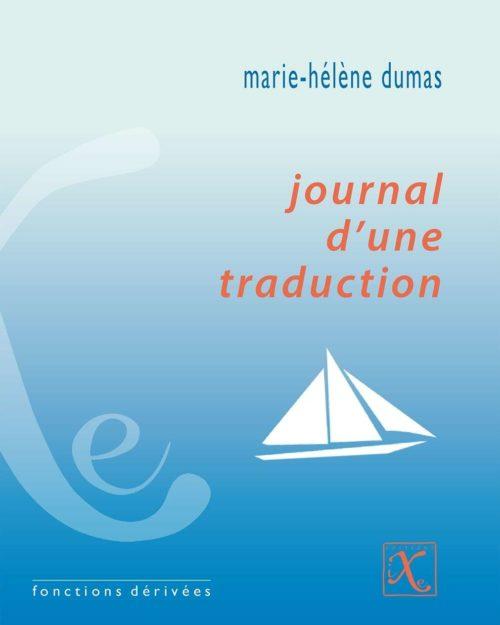Toutes peines confondues
De la disparition forcée à l’engagement citoyen, parcours d’une ex-détenue politique marocaine
Chaque mot que je pose sur le papier est une victoire contre l’oubli, une affirmation de ma dignité et de ma résistance.
Fatna el-Bouih a vingt et un ans lorsqu’elle est arrêtée en 1977 pour “atteinte à la sûreté de l’État”. Sous le règne du roi Hassan II, son pays, le Maroc, vit la tourmente des “années de plomb” au cours desquelles la torture, les disparitions forcées, les détentions arbitraires sont utilisées à tout-va contre les opposant·es au régime.
Première prisonnière politique marocaine à avoir publié sur son expérience carcérale, Fatna el-Bouih s’est saisie de la plume comme d’une arme : à la fois pour témoigner des violences spécifiques qui sévissaient alors dans les quartiers pour femmes des prisons, et pour reprendre pied dans le monde des vivants, ancrer son parcours dans une histoire collective.
D’abord publié en arabe par la maison d’édition marocaine Le Fennec, puis en français par le même éditeur sous le titre Une femme nommée Rachid, le texte initial a été considérablement remanié et enrichi pour pouvoir être lu et compris par-delà les rives de la Méditerranée.
17.00€
À propos de l'autrice
Militante pour les droits humains, féministe, Fatna el-Bouih est cofondatrice de l’Observatoire marocain des prisons, du Forum Vérité et Justice et de l’association Relais-Prison-Société.
Caractéristiques
| ISBN | 979-10-90062-85-6 |
|---|---|
| Format | 14 x 18 cm |
| Pages | 160 |
| Parution le | 28 mars 2025 |
Revue de presse
Kenza Sefrioui
« Chaque mot que je pose sur le papier est une victoire contre l’oubli, une affirmation de ma dignité et de ma résistance », écrit l’autrice. Ce témoignage brise deux murs de silence : celui des tortionnaires, mais aussi celui imposé au nom de la hchouma. Il contribue à documenter les atrocités des années de plomb et rejoint en cela les témoignages des hommes. Il est surtout un rappel de la place des femmes dans les mouvements 23 Mars et Ilal Amam, minorée voire invisibilisée par le récit patriarcal.