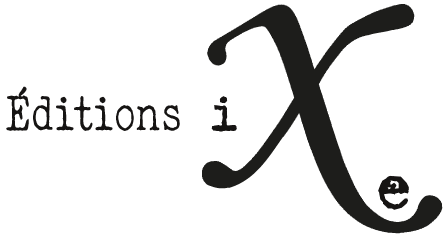« Dé-policer la grammaire, dés-orthographier les figures de la subjectivité dans la languécriture… Mais comment, et jusqu’où ? »
Très académiquement ordonnée en deux genres – d’un côté le masculin/neutre /universel, de l’autre le féminin – la langue française se laisse depuis quelque temps gagner par un tumulte graphique dont ces Passions polygraphes se font l’écho.
Aux parenthèses qui encageaient le petit e muet du féminin, les « scribes indociles » préfèrent désormais les tirets, les points, médians ou non, la majusculE finalE ou l’indicible astérisque. En créant ille, yel, lua, dea, cil… iels élargissent la gamme des pronoms avec l’intention, poétique et politique, d’ouvrir la « languécriture » à des voix, des vies recouvertes, confisquées, mutifiées par l’imperium du masculin.
Risquant « un pas au-delà », Katy Barasc, en philosophe, cherche le signe ou la dé-marque qui viendrait inscrire dans la langue ce qui ne peut s’y prononcer. Et qui, ainsi, exempterait enfin le JE, le NOUS, le TOI de toute assignation sexuée.
Entre passions tristes des vigiles de l’ortho-graphie et passions joyeuses des iconoclastes, ce qui bruisse dans ces pages est autant inquiétude du savoir de soi que jouissance de l’écriture.